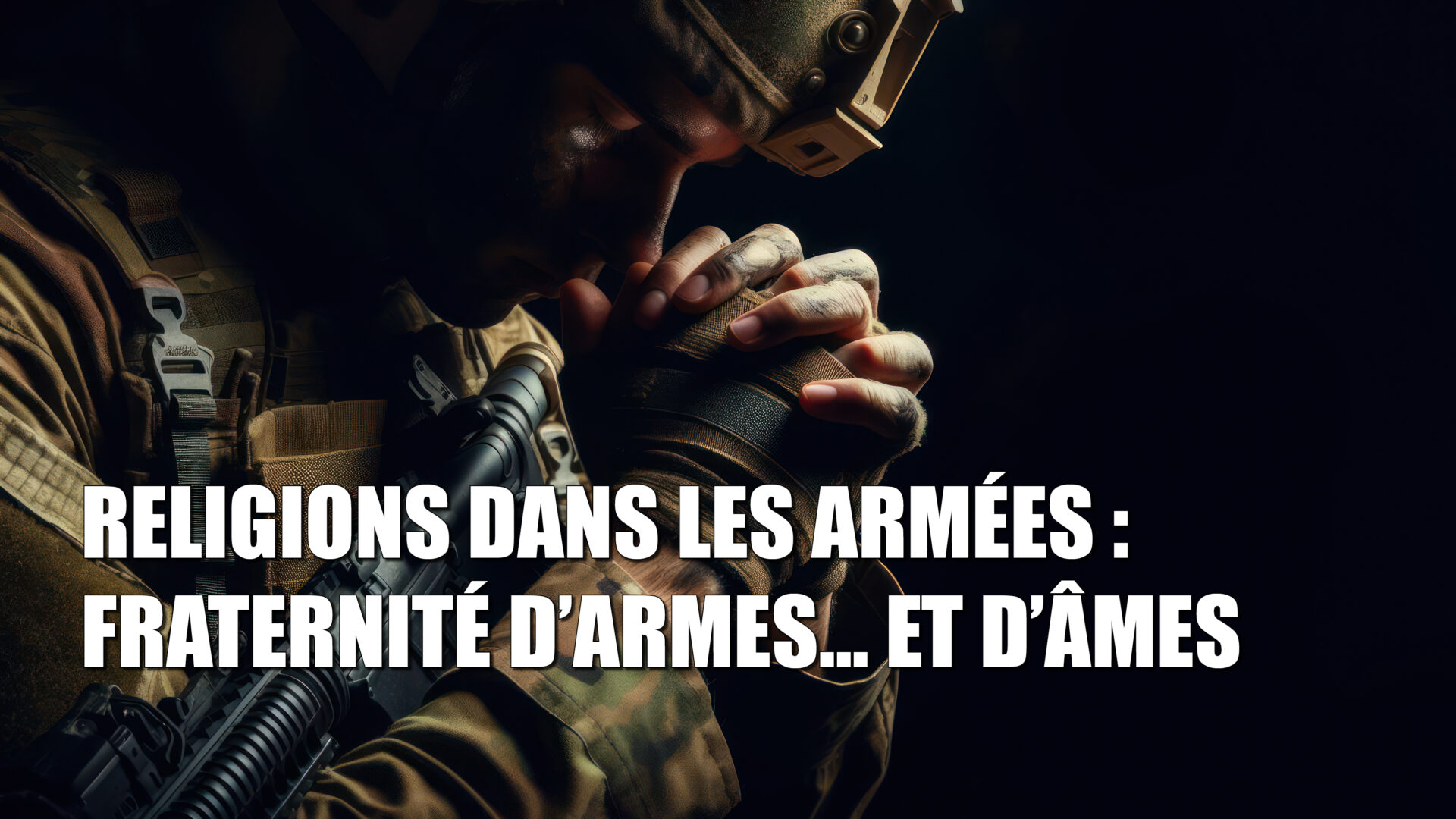 Avec des aumôniers militaires de quatre cultes (catholique, protestant, musulman et israélite), les armées françaises bénéficient d’un modèle unique alliant le respect de la neutralité de l’État et celui de la liberté de conscience. Explications avec des représentants de chacune des religions.
Avec des aumôniers militaires de quatre cultes (catholique, protestant, musulman et israélite), les armées françaises bénéficient d’un modèle unique alliant le respect de la neutralité de l’État et celui de la liberté de conscience. Explications avec des représentants de chacune des religions.Les soldats peuvent donner la mort ou la recevoir. Aussi ancienne que la guerre, cette dure réalité humaine a conduit historiquement les armées à s’adjoindre la présence de ministres des cultes pour apporter un soutien spirituel aux combattants. Dans la France médiévale, quand le roi ou le suzerain appelait à « l’ost » (l’armée en campagne), le seigneur s’y rendait avec écuyer, archers, soldats mais aussi chapelain.
En plus des aumôniers catholiques présents de longue date, les aumôniers protestants sont officiellement reconnus depuis la guerre de Crimée, en 1854. C’est ensuite la loi du 8 juillet 1880, toujours en vigueur, qui institutionnalise juridiquement l’aumônerie militaire moderne, en reconnaissant trois cultes : catholique, protestant et israélite. Des aumôniers musulmans sont documentés dans l’armée française dès la Première Guerre mondiale, mais c’est par l’arrêté interministériel du 16 mars 2005 que leur aumônerie a rejoint officiellement les trois autres cultes.
Chacun des quatre cultes est dirigé par un aumônier en chef (AUMC), dont le rôle est notamment d’assurer la coordination entre leur tutelle militaire (l’état-major des armées) et leur rattachement spirituel auprès des instances de leur religion. Des aumôniers militaires (AUM) sont présents dans toutes les structures des armées : l’armée de Terre (dont les services de renseignement et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris), celle de l’Air et de l’Espace, la Marine nationale (dont les marins-pompiers de Marseille), la Gendarmerie nationale et le Service de santé des armées.
ILS ONT LE GRADE DU SOLDAT AUQUEL ILS S’ADRESSENT, DU 2E CLASSE AU 5 ÉTOILES
Rémunérés par l’armée comme officiers d’active ou de réserve, les aumôniers sont sous statut militaire, avec cette particularité d’avoir un grade « transparent » : celui du soldat auquel ils s’adressent, du 2e classe au 5 étoiles. Autre particularité, les quatre cultes comprennent des femmes officiant comme aumôniers militaires, ces derniers n’étant pas nécessairement prêtres, imams, rabbins ou pasteurs.
Au total, servent actuellement dans les armées françaises 210 aumôniers catholiques, 65 protestants, 30 musulmans et 18 israélites.
« L’aumônier porte le treillis et l’uniforme comme tous les soldats, marins ou aviateurs, il part en opération avec eux, est disponible pour eux », souligne monseigneur Antoine de Romanet, AUMC du culte catholique et, au sein de l’épiscopat français, évêque aux Armées depuis 2017 :
« Ce sont d’abord des personnes qui soutiennent positivement en toutes circonstances. Outre leur mission cultuelle, ils ont une mission d’accompagnement humain : celle d’apporter une écoute bienveillante, positive et confidentielle, à tous les soldats, qu’ils soient croyants ou pas. »
Cela les conduit parfois à soutenir des soldats d’autres religions que la leur. Antoine de Romanet mentionne l’histoire, pendant la Première Guerre mondiale, d’un rabbin apportant une croix à un soldat catholique mourant, en l’absence d’un aumônier de son culte.
« NOTRE FONCTION EST UTILE POUR LIBÉRER LA PAROLE »
En poste à l’École militaire depuis 2020, Véronique Dubois est aumônier du culte israélite (dont l’AUMC est le grand rabbin Joël Jonas). Devenue AUM en 2010, cette ancienne journaliste et chef de projets culturels a d’abord exercé dans des hôpitaux d’instruction des armées comme Bégin et le Val-de-Grâce. « Notre fonction est utile pour libérer la parole », estime-t-elle, « et l’aumônier peut constituer une sorte de soupape de sécurité puisqu’il est en dehors de la hiérarchie ».
Elle se rappelle un long échange, quand elle exerçait à l’hôpital, avec un militaire musulman en plein doute, alors que l’aumônier de son culte était parti en opération extérieure (OPEX) :
« Il avait été blessé dans des combats en Afrique face au groupe djihadiste Boko Haram, et s’interrogeait sur l’attitude à avoir face à une femme combattante. Je lui ai dit que sa capacité à discerner entre le bien et le mal devait le recentrer et le conforter dans sa foi et son statut de militaire français. »
Le même genre d’expérience œcuménique est arrivé à l’aumônier musulman Kamel Driouech, parti six fois en OPEX :
« Au Tchad, un jeune soldat protestant qui souffrait d’un mal-être terrible est venu voir tour à tour les trois aumôniers présents sur place, le protestant, le catholique et moi. Il m’a demandé de prier pour lui. Nous avons donc prié ensemble, lui à sa manière, moi à la mienne. Ayant butiné ainsi dans chaque spiritualité, il s’est trouvé mieux et nous en a remerciés. »
Kamel Driouech constate que les militaires viennent plus volontiers le voir en opérations que lorsqu’ils sont dans leurs unités, en France. « Pour eux, dans ces circonstances, discuter avec un aumônier semble être une bouffée d’oxygène », dit-il.
« EN OPEX, NOUS PARTAGEONS NOTRE ESPACE DE VIE ET NOTRE POPOTE »
Les échanges y sont aussi plus fréquents entre AUM de différents cultes, alors que leur charge leur laisse peu de temps pour se voir en France. « En général, nous partageons notre espace de vie et notre popote, même si nos lieux de culte sont séparés », précise l’aumônier musulman.
Depuis son bureau de l’École militaire, il sert aussi d’autres unités en Île-de-France, dont des groupements de sapeurs-pompiers de Paris. Entré dans l’armée en 2009 après un début de carrière de manager dans l’industrie automobile et de nombreux engagements dans l’éducation des jeunes, Kamel Driouech fait partie des plus anciens aumôniers de son culte, dont l’AUMC est Nadir Mehidi.
À l’écoute des athées comme des fidèles d’autres religions, les AUM respectent aussi les sensibilités individuelles au sein de leur propre culte. C’est particulièrement le cas pour le protestantisme, qui rassemble de nombreuses Églises (réformées, luthériennes, évangéliques…), dont 19 sont représentées dans les armées. « La plupart du temps, les personnels ne me demandent même pas quelle est la mienne », relate Nelly Butel, aumônier du culte protestant (dont le chef est Étienne Waechter) à l’École militaire, et elle-même baptiste :
« Lorsque je prépare une célébration cultuelle, je m’adapte à tous, je fais en sorte que chacun s’y retrouve », indique cette ancienne libraire engagée dans l’armée depuis huit ans.
L’AUM israélite Véronique Dubois reçoit dans son bureau des civils ou militaires représentant toutes les tendances de son culte (orthodoxe, libéral, observants ou non…) et aussi d’autres croyances. Elle organise mensuellement des temps de lecture comparée de la Bible avec des fidèles des trois religions du Livre (judaïsme, christianisme et islam) et s’est déjà retrouvée à déjeuner au mess avec des officiers saoudiens de passage à Paris.
LES AUMÔNIERS TRANSMETTENT DES « SIGNAUX FAIBLES » AU COMMANDEMENT
Aux fonctions cultuelles et d’accompagnement humain des aumôniers s’ajoute, selon les circonstances, un rôle de conseil au commandement : « Tous les sujets possibles et imaginables sont portés par l’armée, et entrent dans cette mission de conseil au commandement des aumôniers », explique Antoine de Romanet.
Les aumôniers peuvent ainsi transmettre des « signaux faibles », donner l’alerte s’ils « sentent » un trouble au sein des troupes. En opérations, il leur est donc nécessaire faire preuve « de souplesse, de pragmatisme et d’intelligence », ajoute l’AUMC catholique, qui résume d’une formule : « Ils doivent être multimilieux, multichamps », tout comme les autres soldats.
Parmi les signaux que Véronique Dubois a pu faire remonter au commandement, ce cri du cœur d’un militaire de retour d’Afghanistan, meurtri par le manque de reconnaissance du grand public : « Madame, dites-leur ce que nous avons fait pour la nation ! » En tant que femme, l’AUM israélite constate que « le personnel masculin se livre plus facilement, peut-être parce que nous ne sommes pas dans ce rapport d’homme à homme » fréquent dans leur quotidien.
Nelly Butel prépare en ce moment le prochain rassemblement international militaire protestant, qui se tient chaque année en France depuis 1951. « Dans le contexte géopolitique actuel, la fraternité internationale est importante », souligne-t-elle.
« Des aumôniers de plusieurs cultes et de différents profils présents en permanence permettent d’apporter aux soldats un soutien humain, moral et spirituel », estime l’AUM protestante. « C’est cette complémentarité entre aumôniers qui fait la grande force de notre modèle. »
LA LAÏCITÉ, « ÉLÉMENT D’ARTICULATION ESSENTIEL ENTRE RÉPUBLIQUE ET RELIGIONS »
À ceux qui s’étonnent que la « laïcité à la française » autorise l’État à rémunérer des militaires pour une fonction cultuelle, Antoine de Romanet répond fermement :
« La laïcité n’est un problème que pour ceux qui ne l’ont pas étudiée en profondeur. Ceux qui la pratiquent dans la réalité du quotidien savent qu’elle est un élément d’articulation essentiel entre la République et les religions. Avec elle, chacun est reconnu et respecté dans sa pleine consistance, et dans le respect de la légitime et précieuse neutralité de l’État. La laïcité est un élément structurant de la liberté de conscience et de nos États démocratiques, et l’armée est tout à fait exemplaire sur ce point. »
L’IHEDN accueille les représentants des cultes dans ses différentes sessions, au même titre que d’autres relais d’opinion comme les journalistes, avocats, responsables associatifs ou syndicaux.
Source : Lundis de l’IHEDN
21/04/2025


![[LUNDIS de l’IHEDN]Religions dans les armées : fraternité d’armes… et d’âmes](https://www.asafrance.fr/wp-content/uploads/2025/05/ARMEE_RELIGION-1080x675.jpg)
